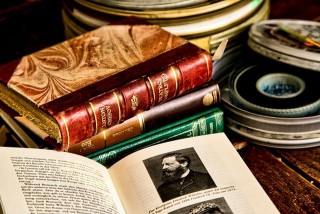Le blog
Écologie et fiction, l’essor du roman climatique
Il fut un temps où les préoccupations environnementales restaient l’apanage des essais scientifiques, des rapports alarmants ou des documentaires. Mais aujourd’hui, la littérature s’empare de l’urgence climatique, et un genre émerge lentement mais sûrement dans les rayonnages : le roman climatique, ou cli-fi (climate fiction).
La naissance d’un genre engagé
Ce n’est pas un genre totalement nouveau, mais il prend un élan inédit face à la crise environnementale actuelle. On pourrait en retrouver les prémices chez J.G. Ballard dans les années 60 (Le Monde englouti), ou même dans la science-fiction post-apocalyptique. Mais depuis les années 2000, une bascule s’opère : les récits ne parlent plus d’un futur lointain, mais d’un présent altéré, d’un monde déjà en mutation.
Des auteur(e)s comme Margaret Atwood (Le Dernier Homme), Kim Stanley Robinson (New York 2140) ou Jean-Marc Ligny en France (Aqua™, Exodes) explorent un monde où le climat recompose nos sociétés, nos villes, nos rapports humains.
Un miroir brûlant de notre époque
Ce qui distingue le roman climatique, c’est sa volonté de fictionnaliser les conséquences concrètes du dérèglement climatique : montée des eaux, réfugiés environnementaux, effondrement des écosystèmes, conflits pour les ressources. Le roman devient un laboratoire d’idées, une projection imagée de notre inaction ou de nos choix futurs.
Mais ce genre ne cherche pas uniquement à faire peur. Il questionne aussi notre capacité de résilience, d’adaptation, et parfois d’espoir. Certains auteurs y voient un outil de sensibilisation, bien plus puissant que les chiffres ou les graphiques.
Pour les francophones aussi, le climat inspire la fiction
En littérature francophone, des auteurs s’illustrent dans ce sillon. Citons Émilie Querbalec ou Catherine Dufour, qui entremêlent SF, dystopie et écologie. Même la littérature blanche s’en empare : Delphine Coulin (Une fille dans la jungle) ou Sylvain Tesson, à sa manière contemplative, dressent des portraits de nature en péril.
Les maisons d’édition suivent aussi cette tendance, créant parfois des collections dédiées, ou intégrant une dimension éco-littéraire dans leur ligne éditoriale. Le roman climatique devient aussi un enjeu éditorial : comment proposer un discours engagé sans tomber dans le didactisme ? Comment garder l’attrait narratif tout en portant un message politique ou écologique ?
Si la littérature a toujours su capter les angoisses de son temps, elle sait aussi offrir des voies de réflexion, voire des graines d’espoir. Et peut-être, demain, le roman climatique ne sera-t-il plus seulement un avertissement, mais un manuel de survie poétique.